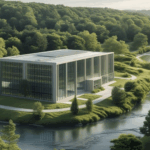Quelques semaines après l’annonce de l’implantation de centres de données en France, l’heure est à l’ambivalence. Oui, il faut implanter des data centers sur notre territoire pour héberger nos données de manière sure et souveraine. Oui, la France doit prendre toute sa part dans l’essor de la filière numérique et faire partie des meilleurs hub mondiaux de la donnée. Oui, les territoires doivent consacrer une partie de leur foncier à ces implantations. Mais jusqu’à quel point ? Quelles seront les retombées pour les citoyens ? Une question cruciale pour les centres de données : être accepté par les territoires ou prendre le risque de prendre un retard précieux dans leur accès au marché français.
Des data centers acteurs de la transition énergétique
Les centres de données consomment des ressources – électricité, eau, foncier – mais ils émettent eux aussi de l’énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur, dite « fatale », peut être réutilisée pour chauffer des bâtiments ou réinjectée dans des chaînes de productions industrielles. Certains constructeurs de centres de données, comme l’entreprise Qarnot qui conçoit et installe des data center de taille moyenne, font de la valorisation de la chaleur un pilier de leur modèle économique. « La récupération et la valorisation de notre chaleur est notre premier critère d’implantation. Nous ne nous implantons pas dans un territoire sur lequel il n’y a pas d’opportunité de réutiliser notre chaleur.. Par exemple, des centres ludo-aquatiques. ». De même, le constructeur Data 4 implanté à Marcoussis en Essonne valorise sa chaleur pour favoriser la culture de micro-algues sur le territoire. Pour autant, tous les data centers n’en font pas autant et considèrent la chaleur comme un corollaire à leur activité dans pour autant en faire une réelle stratégie d’ancrage sur le territoire. Alors que la production de chaleur est un argument de taille pour les data center qui souhaitent garantir leur acceptabilité territoriale.
Afin d’en faire un réel argument, quelques étapes sont clé :
- Ajouter des briques technologiques au centre de données pour récupérer la chaleur à la bonne température et de manière constante, afin qu’elle puisse être valorisée et réutilisée été comme hiver. Sans cet ajout, la production de chaleur reste intermittente et ne peut être injectée efficacement dans les réseaux de chaleur existants ou branchée sur des infrastructures énergétiques locales. A contrario, lorsque la chaleur est maîtrisée, elle peut donner lieu à des contrats long terme de récupération de la chaleur
- Identifier les opportunités de récupération de la chaleur sur le territoire. Existe-t-il un réseau de chaleur ? Des infrastructures qui nécessitent un apport d’énergie été comme hiver ? Cette étape peut nécessiter la conduite d’une étude, menée par la collectivité et financée par des dispositifs publics et privés. Parmi les dispositifs publics, les missions d’ingénierie portés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires et en particulier Territoire d’industrie. Parmi les dispositifs privés, de nombreux fonds de dotation mobilisent des fonds privés pour soutenir les efforts des associations et des collectivités en matière de transition énergétique (e5t, Générations transition…)
- Enfin, une fois la stratégie écrite, il faut envisager une structuration juridique de la revente de la chaleur et du co)investissement dans les infrastructures et les réseaux.
Des data centers engagés dans les solidarités locales
Comme toute entreprise qui s’implante sur un territoire, un data center peut s’engager dans des actions solidaires. C’est le cas de la majorité des grands groupes indsutriels, soucieux de leur impact et de leur acceptabilité locale. Les outils les plus courants pour engager un mécénat local sont les fondations d’entreprise et les fonds de dotation.
Parlons en particulier des fonds de dotation, comme le fonds Sesame en Isère qui mobilise les entreprises locales, de la PME au grand donneur d’ordre, au service de l’inclusion et des solidarités. Un dispositif encore trop peu connu et pourtant plus flexible qu’une fondation ; pour le lancer, il suffit d’une mise de départ limitée, de la rédaction de statuts déposés à la préfecture, et de la constitution d’une gouvernance adaptée (conseil d’administration et comité consultatif lorsque les fonds engagés excèdent 1 million d’euros). La principale difficulté représente l’énergie de départ à mettre dans le projet ; mais une fois lancé, le véhicule de financement permet à toute entreprise de soutenir un écosystème local dynamique et solidaire.
Des data centers locomotives de l’écosystème économique territorial
Enfin, les data centers ont leur rôle à jouer dans la constitution des filières économiques du territoire. En collaboration avec l’ensemble des parties prenantes territoriales, ils peuvent contribuer à l’attractivité du territoire et à la construction de filières entières, résilientes et pourvoyeuses de retombées locales. Par exemple, Digital realty a, en 10 ans, fait de Marseilles un hub mondial de la donnée.
Pour cela, une démarche construite d’engagement avec le territoire doit être construite. Ainsi, chaque entreprise connait précisément les attendus du territoire au quotidien et peut concentrer ses efforts là où l’impact sera le plus fort. C’est la logique des pactes entreprise-territoire qui sont en cours d’expérimentation. Compagnum a en particulier mis en place un pacte industrie-territoire dans le cadre du Territoire d’industrie Rochefort-Royan-Marennes-Oléron, avec pour vocation le déploiement de tels pactes dans les autres territoires français.
Pour se lancer, voici les étapes clés :
- Identifier les grands enjeux rencontrés par le territoire et les collectivités territoriales. Par exemple : la transition énergétique, le logement, la mobilité, l’emploi des jeunes…
- Constituer un collectif d’entreprises locales, de la TPE au donneur d’ordre, qui souhaite s’engager dans une démarche collective d’engagements réciproques
- Valoriser l’existant, par exemple : les engagements déjà pris par la collectivité vis-à-vis des entreprises, les fiertés industrielles locales
- Enfin, animer le collectif de manière à formuler collectivement des engagements réciproques entreprise-territoire à prendre chaque année et sur lesquels s’engager pour une durée de 3 ans
Le pacte doit donner lieu à des indicateurs simples à suivre et célébrés régulièrement, par exemple au cours des rencontres économiques du territoire.
Lorsque de tels pactes existent, il est avantageux pour les data centers de s’y inscrire afin de s’ancrer sur les territoires comme toute entreprise (industrielle ou non) le fait à l’heure actuelle. De ST Microelectronics à Airbus en passant par notre tissu de PME et d’ETI, la conviction de l’ancrage territorial gagne du terrain et devient un « must have » pour un réel engagement sociétal. Des actions concrètes et visibles de tous, qui oeuvrent comme un garde fou contre les effets de communication et le « green washing ».